Il a été une star du dessin de presse dans les années 1970. Il officiait alors dans les colonnes du Monde.
Et puis Konk s’est mis à douter, à douter de tout. Y compris de la réalité des chambres à gaz.
Ostracisé, il a fini sa carrière dans la presse d’extrême droite. Aujourd’hui à la retraite, il ne cesse de remâcher cette mise à l’écart. Mais sans jamais revenir sur ses convictions.
AVERTISSEMENT
Interviewer quelqu’un qui s’affiche comme un révisionniste n’est pas anodin. Et ne se décide pas à la légère. Nous y avons longuement réfléchi avant de prendre contact avec Konk. Mais, viscéralement attachés à la liberté d’expression, nous ne pouvions accepter qu’il devienne une sorte de pestiféré du seul fait de ses prises de position. Nous ne pouvions nous y résigner. D’autant que Médias donne systématiquement à entendre des points de vue radicalement opposés. Notre marque de fabrique.
Reste qu’il n’était pas question de mener cette interview en taisant nos positions et, en l’occurrence, notre répulsion pour ce révisionnisme qui, en niant les faits, blesse, meurtrit tous ceux qui ont eu à souffrir de l’Holocauste. Il n’est pas inutile de le dire – même si, nous semble-t-il, cela saute aux yeux à la simple lecture – tant, en France aujourd’hui, certains sont pris d’un goût effréné pour tout judiciariser, menaçant des tribunaux y compris ceux qui tentent simplement de voir et de comprendre.
Enfin, et c’est ce qui a emporté notre décision, il nous est apparu, après avoir rencontré Konk, que nous tenions là un début d’explication à ces questions : comment devient-on révisionniste ? Par quels détours et sur quel terreau intime ? À partir de quelle structure intellectuelle ? Une partie de la réponse réside dans les mots d’un Konk qui se raconte, ici, sans cacher la dimension très personnelle de ce qui ressemble à une dérive. Il le dit avec une rage rentrée. À l’heure où Céline refait l’actualité, les propos de Konk — et ses dessins — nous semblent d’un intérêt certain.
Vous avez toujours dessiné ?
Plus ou moins. En réalité, je n’avais pas trop le choix : je n’ai pas suivi beaucoup d’études... Il fallait bien que je fasse quelque chose. Et puis, j’avais envie de réussir. J’ai eu beaucoup de chance : j’ai envoyé mes dessins un peu partout. C’est Tim, un dessinateur de L’Express, qui m’a envoyé chez Fauvet, qui prenait la direction du Monde à cette époque-là, en 1969.
Politiquement, vous étiez de quel bord ?
Je ne sais pas bien. Peut-être rien du tout. Mes parents étaient plutôt conservateurs. Mais j’ai quand même participé aux manifs de 68 : je me souviens que je ne chantais pas l’Internationale car je n’en connaissais pas les paroles. Certains me regardaient de travers et devaient sentir que je n’étais pas un rouge bien convaincu...
Pourtant vos dessins dans Le Monde étaient des dessins politiques...
Ils le sont très vite devenus. Mais bon, j’avais 25 ans : on est de gauche à cet âge-là, c’est normal ! À 25 ans, dessiner dans le journal le plus prestigieux, ce n’est pas rien !
C’est vrai. Je n’avais aucune formation et je me suis retrouvé au milieu des plumes les plus connues. Un vrai conte de fées...
Vous êtes devenu une star du dessin ?
Ça m’a suivi et, d’une certaine façon, protégé. Encore aujourd’hui, certains me présentent comme « ancien dessinateur du Monde », comme si...
Vous trouvez cela injustifié ?
C’est effrayant ! Et très certainement exagéré. Cela aurait pu être n’importe qui d’autre. Je n’étais pas le meilleur dessinateur. Sans doute celui qui en voulait le plus, qui avait les dents les plus longues parce que j’avais l’épée dans les reins : il fallait que je réussisse.
Pas plus de talent que les autres ? Ce n’est pas ce que disent vos confrères dessinateurs... Wolinski dit de vous que vous étiez le plus doué de tous les dessinateurs politiques. Chenez et Plantu, que votre trait est extraordinaire...
Ils ne sont pas les plus mal placés pour en juger ! Je n’ai jamais pensé être un bon dessinateur : j’ai toujours souffert. Reiser avait un trait. Pour moi, ça a toujours été laborieux, j’ai toujours tiré la langue, percé mes feuilles à force de gommer, de recommencer. Et puis, parfois, j’étais content. Travailler beaucoup avait les avantages de ses inconvénients...
Un bosseur ?
Pourtant très paresseux. Un travailleur contraint. Je ne lâchais jamais un dessin tant qu’il ne me plaisait pas. J’ai bouffé de la gomme.
En 1973, alors que tout va bien, vous quittez Le Monde : que s’est-il passé ?
Je voulais monter une coopérative ouvrière de peinture en bâtiment. Comme mes parents adoptifs ne savaient pas quoi faire de moi car j’étais mauvais élève, ils m’avaient confié durant un an à un cousin, métreur en peinture (cela consiste à prendre des mesures pour établir des devis ou des mémoires). J’étais donc un peu du métier. Mais la coopérative a été un fiasco malgré ses dix-sept ouvriers. Pour gagner des clients, j’avais un secret : je pratiquais des prix nettement moins élevés que les autres. Du coup, c’était la fuite en avant permanente... Un vrai cauchemar !
Pourquoi cette coopérative ?
Je ne trouvais pas honnête de simplement revendiquer de meilleures conditions de travail ou de meilleurs salaires pour les ouvriers : il fallait mettre la main à la pâte. Mais je me suis rendu compte que les ouvriers eux-mêmes ne cherchaient pas forcément l’égalité entre nous : ce qu’ils désiraient, c’était que l’entreprise tourne. Ils m’envoyaient chercher des chantiers mais n’avaient pas très envie que je travaille à leurs côtés : chacun son rôle ! Bref, une espèce de malentendu assez drôle...
Au bout de deux ans, vous retournez au Monde...
Oui, pour payer mes dettes auprès de l’Urssaf. J’ai tout remboursé en quelques mois.
À votre retour, vous êtes à l’aise avec la ligne éditoriale du Monde ?
On veut toujours plaire à son employeur... Moi, je voulais la peau de Giscard. Alors qu’en fait, il n’était certainement pas pire qu’un autre. Mais c’était mon job de taper sur lui et je le faisais volontiers.
Votre job ou ce que vous pensiez ?
On s’arrange toujours pour penser ce qu’on a intérêt à penser. Le Monde, à cette époque, était tout à fait dans mes vues : on allait vers les matins radieux et le programme commun. Sans compter que l’on gagnait tous confortablement notre croûte... Il suffisait d’entrer chez Jacques Sauvageot pour demander une augmentation : on l’obtenait d’office.
Aucun état d’âme sur ce qu’écrivait le journal ?
Il était bien à gauche à l’époque et je l’étais encore moi-même puisque je klaxonnais dans le bois de Vincennes pour saluer l’élection de Mitterrand.
L’arrivée de la gauche au pouvoir change quelque chose ?
Mon boulot consistait à être antitout. Quand le PS est arrivé au pouvoir, j’ai eu envie de taper dessus, tout naturellement. On m’a un peu freiné. On m’a demandé de lui donner le temps... Il fallait épargner les nouveaux arrivants et cela ne me plaisait pas trop. Mais je n’ai pas quitté Le Monde parce qu’on me censurait : en réalité, il s’agissait d’une histoire de cœur ! Je sais, c’est risible. On ne fait pas les choses pour une seule raison : la plupart du temps, c’est une accumulation de petits détails qui vous poussent un jour à prendre une décision.
Vous atterrissez au Matin ?
Le mitterrandisme jusqu’au bout des ongles. Mais je n’y faisais pas de dessin politique : je m’étais lancé dans une BD préhistorique...
Puis, c’est L’Événement du jeudi ?
Ça se passe très bien avec Jean-François Kahn. Il me laisse faire ce que je veux. Jusqu’au procès Barbie.
C’est-à-dire ?
Au tout début des années 1980, des copains journalistes au Monde m’avaient fait lire des écrits de Faurisson. Au départ, comme tout le monde, je croyais à l’existence des chambres à gaz. Eux, qui étaient juifs, avaient été très troublés par ces textes. Dans leur communauté, le travail de Faurisson avait été très étudié et beaucoup s’étaient laissé convaincre par ses thèses avant, finalement, de rentrer dans le rang. À L’Événement du jeudi, j’étais très marqué par ces théories et j’ai dessiné Barbie en déporté avec une croix gammée cousue sur la poitrine derrière des barbelés. Encore une fois, Kahn a été très correct puisqu’il a accepté de passer mon dessin. Ensuite, Jean-Francis Held m’a demandé de partir, ce que j’ai fait.
Franz-Olivier Giesbert vient alors vous chercher pour travailler au Figaro ?
Il voulait sauver mon âme... Beaucoup avaient une espèce de nostalgie de ce que j’avais été et pensaient que j’étais devenu fou. Il fallait faire quelque chose pour moi, malgré moi.
Vous étiez vraiment devenu fou ?
Je ne pense pas, mais c’est vrai que le révisionnisme a pris chez moi une très grande place. C’est devenu le centre de mon existence. On parle de l’Holocauste, ou du moins on y fait allusion, trente fois par jour. C’est le pivot du monde occidental. L’histoire des cinquante dernières années de notre société est construite autour de cela, qu’il s’agisse de la morale, de la littérature, du cinéma ou de la politique. Je me sens constamment renvoyé à cela et agressé. Une véritable obsession.
Mais comment pouvez-vous douter de la Shoah ?
Mes doutes sont nourris par des arguments, des invraisemblances. Quand on accepte de regarder les choses en face, sans les œillères que nous avons l’habitude de porter lorsque l’on aborde cette question, il est évident qu’on est en face d’une incroyable exagération, voire d’un mensonge... Mais ce n’est pas propre à la Seconde Guerre mondiale. C’est la même chose avec le génocide arménien ou l’esclavage. Je crois que l’on devrait étudier d’un peu plus près toutes ces vérités qu’on nous assène... En fait, ce dont j’ai honte, c’est d’avoir cru si longtemps à ces horreurs sans même chercher à les vérifier. Ce n’est pas d’être révisionniste qui est honteux, c’est de ne pas l’être !
Les camps de concentration ont bien existé !
La thèse révisionniste consiste à dire qu’il n’y a pas eu intention d’exterminer les Juifs. Oui, il y a eu des déportations massives. Mais sans volonté d’extermination.
Ils étaient pourtant visés en tant que tels !
Oui, certainement. Au moins les juifs étrangers, car il ne me semble pas que les Juifs français aient été autant déportés que les autres.
Vous niez l’intention de tuer...
Les nombreuses personnes qui sont mortes dans ces camps ont davantage subi le typhus qu’une volonté délibérée de les assassiner... Le gros de l’hécatombe date de 1945, époque des terribles épidémies de typhus...
Vous citez toujours Faurisson. Mais il y a eu d’autres travaux, rédigés par des historiens extrêmement sérieux, et qui disent d’autres choses : pourquoi croire Faurisson et pas les autres ?
C’est sa démonstration de l’utilisation du Zyklon B qui a emporté mon adhésion. Les témoignages fournis sur la façon d’opérer ne correspondent pas aux précautions drastiques qui auraient dû être prises face à un produit aussi dangereux. Cela ne peut pas s’être passé ainsi. C’est invraisemblable... Et j’en veux aux journalistes, étant donné les conséquences, de ne pas être allés vérifier ces détails-là ! Au lieu de vérifier les informations, on se contente, par fainéantise, d’estimer leur crédibilité à vue de nez.
Vous connaissez Faurisson personnellement ?
Je l’ai rencontré plusieurs fois, et vu pas plus tard que l’été dernier chez lui à Vichy. Il habite dans un petit pavillon, dans une rue tranquille ; pas un seul graffiti sur les murs, c’est étonnant.
Comment expliquez-vous l’importance que ces positions ont prise dans votre vie ?
Je ne comprends pas que cela n’en ait pas plus pour vous ! On a découvert que la Terre était ronde, et vous ne voulez pas qu’on en parle sous prétexte que tout le monde dit qu’elle est plate... Mais elle est ronde et ça change tout ! Même si le dire est dangereux.
Ça a bousillé votre carrière ?
Oui.
Votre carrière ou votre vie ?
Je n’en sais rien. Quelques-uns gardent encore un peu d’admiration pour moi. Mon côté « seul contre tous ». Je n’étais pas assez docile. J’ai toujours rué dans les brancards. Mes idées étaient aussi peut-être un prétexte pour moins travailler. Allez savoir ! Il faut la tenir la place au Monde, il faut les pondre les dessins chaque jour. J’ai longtemps été pigiste et on ne mange que s’il y a publication... Certains le vivaient très bien. Moi, dès qu’on me refusait un dessin, je le prenais comme une offense personnelle. Une espèce d’orgueil mal placé... Vous n’imaginez pas combien je me suis senti libéré lorsque j’ai cessé de dessiner.
Une vraie pression ?
C’est affreux. Tout en donnant aux autres l’impression de ne rien faire. Ils nous croisent toujours les mains dans les poches à rêver car l’exécution du dessin en elle-même prend peu de temps.
Vous avez fini votre carrière dans la presse d’extrême droite ?
Pas par choix mais parce qu’elle était la seule à m’accepter...
À ce sujet-là, vous avez eu une phrase surprenante : « On est des avocats, on se met au service de nos clients. À Minute, je me suis mis au service de leur cause, le nationalisme. » Vous ne donnez pas vraiment l’impression d’avoir été très convaincu...
C’est vrai, je ne l’étais pas vraiment. Mais je crois que je le suis devenu par la suite...
Quand avez-vous cessé de dessiner pour ces journaux ?
Dès que j’ai pu prendre ma retraite : j’ai posé le crayon et ne l’ai jamais repris. Cela fait quatre ans environ que je ne dessine plus. À part une fois ou deux pour Faurisson qui souhaitait que j’illustre une couverture d’un de ses livres. Je souffrais beaucoup en dessinant. J’ai toujours rêvé d’avoir la technique d’un Cabu ou d’un Reiser. Je ne parle pas de l’inspiration, car je ne suis pas du tout sur la même ligne qu’eux. Mais d’une facilité à laquelle je n’ai jamais accédé.
Plantu pense que vous aviez surpris des journalistes en flagrant délit de mensonge — sur le Cambodge notamment —, et que vous avez alors considéré que l’on pouvait vous mentir sur tout.
Je me souviens en effet de ces grands reporters qui rentraient de reportage avec leur sac à dos. De Centrafrique, où ils écrivaient des conneries sur un Bokassa prétendument anthropophage. Ils vérifiaient à peine leurs informations. Lamentable...
Vous doutez de tout ?
Je suis un douteur professionnel à l’égard du discours dominant. Toutes les thèses un peu conspirationnistes ont ma sympathie, et les concernant, il en faut peu pour me convaincre. Je doute de l’existence de l’esclavage, de celle de Molière (qui serait Corneille), du sida, etc.
Y compris le 11-Septembre ?
Celle qui prétend que l’attentat a été organisé par Israël ou les ÉtatsUnis pour pouvoir intervenir en Afghanistan ? Non, je n’y crois pas, parce que c’est une idée monstrueuse et que je ne crois pas aux monstres.
Comment vous informez-vous ?
Durant trente ans, j’ai enquiquiné ma famille tous les soirs avec le sacro-saint journal de 20 heures. Tout le monde devait se taire. Aujourd’hui, cela ne m’intéresse plus. J’oublie même d’allumer la télé. Et quand elle est en marche, je la regarde d’un œil distrait.
Vous rencontrez encore vos confrères dessinateurs ?
Depuis cette histoire, je suis très isolé. Je doute qu’ils aient très envie de me fréquenter, même s’ils sont tous très gentils. Au fond, ça les a bien arrangés que je garde mes distances.
Vous êtes infréquentable ?
Un peu...
Cela vous rend amer ?
Bien sûr ! J’ai des comptes à régler...
Votre histoire personnelle joue un rôle dans vos convictions actuelles ?
J’ai été abandonné à la naissance et placé dans des familles où ça se passait plus ou moins bien. Mais rien de bien méchant. Les gens étaient même plutôt gentils.
Vous connaissez vos vrais parents ?
Non, mais j’aurais aimé. Pour connaître ma famille : j’ai peut-être des frères et sœurs. Pour avoir des repères aussi. Et des réponses à des questions toutes simples comme l’âge auquel ils sont morts, les maladies qu’ils ont contractées... Je suis né en 1944, donc conçu pendant l’occupation, ceci explique peut-être mon goût pour les nazis !
Vous aimez les gens sur lesquels tout le monde tape ?
Vous avez vu juste. En fait, pas la peine d’aller plus loin. Pas envie d’être du côté du manche. Par exemple, lorsque je travaillais à Minute, j’ai beaucoup tapé sur Bernard Tapie. Et puis, j’ai eu des regrets (il y avait eu le suicide de Bérégovoy) : je me suis dit que cela devait être très difficile à vivre pour lui, tout le monde le détestait. Je lui ai écrit un petit mot pour lui dire de ne pas faire attention à mes dessins, Il n’en a sans doute jamais vu aucun, il ne m’a pas répondu.
Vous regardez ce que font les autres dessinateurs ?
Il y a bien longtemps que je ne lis plus Le Monde. Ça m’intéresse très peu. En général, je n’aimais pas trop ce que faisaient les autres... Et quand j’aimais, j’étais furieux de n’en avoir pas eu l’idée !
Vous êtes influençable ?
J’ai besoin d’être encadré : comme je suis seul, je m’encadre moi-même. Je fume quatre cigarettes par jour et à heures fixes. J’ai décidé de me remettre à l’anglais et je ne lis plus que dans cette langue, mais comme j’ai du mal, je lis deux livres par an maximum. Une sieste tous les jours. Un peu psychorigide... Depuis quelque temps, je me suis raidi, sclérosé.
Chez Ardisson, vous avez dit des journalistes qu’ils étaient « tous à foutre à la poubelle ».
Et je continue à le croire, exception faite des journalistes spécialisés. Ceux de la grande presse n’ont pas fait et ne font pas leur travail. J’ai d’ailleurs décidé de ne plus leur parler, de ne plus répondre à leurs questions. Je n’ai pas de mal puisque aucun journaliste ne me pose de questions, à part vous. Ce sont des escrocs. Parce qu’ils ne sont pas solidaires des victimes du délit de mal penser, et aussi parce qu’ils n’ont pas suffisamment donné la parole aux révisionnistes. Certains ont essayé. Mais, généralement, ils ont pris une claque et sont vite rentrés dans le rang.
Cela ne les empêche pas de dormir, aucun d’entre eux n’a démissionné de quoi que ce soit. Je suis certain que, sur le principe, bon nombre de journalistes sont contre la loi Gayssot. C’est tellement facile. On est contre mais on la laisse s’appliquer. Les journalistes sont là pour informer et ils n’ont pas fait leur boulot : c’est honteux !
C’est la presse qui fait la qualité d’une démocratie. Sans information, le vote des gens n’a aucun sens. Je me souviens de Franz-Olivier Giesbert qui disait : « Si on ne veut pas que Le Pen s’exprime, il suffit de ne pas lui donner la parole. » Mais Giesbert oublie que le journaliste n’est pas là pour décider qui a le droit ou non de parler !
Ils agissent ainsi par suivisme ou par calcul ?
Certainement par facilité, par paresse. C’est tellement plus simple.
Vous ne changerez jamais d’avis sur ces questions ?
J’aime beaucoup les voitures... Éventuellement, contre une Porsche Carrera 3L8, — même d’occasion, mais en bon état —, je pourrais peut-être trahir Faurisson. Faites au mieux !
" Si c'est un homme " par Primo Levi ( 1947 )
Et justement, poussé par la soif, j'avise un beau glaçon sur l'appui extérieur d'une fenêtre. J'ouvre, et je n'ai pas plus tôt détaché le glaçon, qu'un grand et gros gaillard qui faisait les cent pas dehors vient à moi et me l'arrache brutalement. « Warum ? » dis-je dans mon allemand hésitant. « Hier ist kein warum » (ici il n'y a pas de pourquoi), me répond-il en me repoussant rudement à l'intérieur.
Nous avons vite appris que les occupants du Lager se répartissent en trois catégories les prisonniers de droit commun, les prisonniers politiques et les juifs. Tous sont vêtus de l'uniforme rayé, tous sont Haftlinge, mais les droit commun portent a côté du numéro, cousu sur leur veste, un triangle vert, les politiques un triangle rouge , les juifs, qui sont la grande majorité, portent l'étoile juive, rouge et jaune. Quant aux SS, il y en a, mais pas beaucoup, ils n'habitent pas dans le camp et on ne les voit que rarement. Nos véritables maîtres, ce sont les triangles verts qui peuvent faire de nous ce qu'ils veulent, et puis tous ceux des deux autres catégories qui acceptent de les seconder, et ils sont légion. ( ... )
Un fait, en revanche, nous paraît digne d'attention : il existe chez les hommes deux catégories particulièrement bien distinctes, que j'appellerai métaphoriquement les élus et les damnés. Les autres couples de contraires (comme par exemple les bons et les méchants, les sages et les fous, les courageux et les lâches, les chanceux et les malchanceux) sont beaucoup moins nets, plus artificiels semble-t-il, et surtout ils se prêtent à toute une série de gradations intermédiaires plus complexes et plus nombreuses. ( ... )
Mais au Lager il en va tout autrement : ici, la lutte pour la vie est implacable car chacun est désespérément et férocement seul. Si un quelconque Null Achtzehn vacille, il ne trouvera personne pour lui tendre la main, mais bien quelqu'un qui lui donnera le coup de grâce, parce que ici personne n'a intérêt à ce qu'un « musulman (1) » de plus se traîne chaque jour au travail ; et si quelqu'un, par un miracle de patience et d'astuce, trouve une nouvelle combine pour échapper aux travaux les plus durs, un nouveau système qui lui rapporte quelques grammes de pain supplémentaires, il gardera jalousement son secret, ce qui lui vaudra la considération et le respect général, et lui rapportera un avantage strictement personnel; il deviendra plus puissant, on le craindra, et celui qui se fait craindre est du même coup un candidat à la survie. ( ... )
(1) « Muselmann » : c'est ainsi que les anciens du camp surnommaient, j'ignore pourquoi, les faibles, les inadaptés, ceux qui étaient voués à la sélection. (N.d.A.)
Le résultat de cet impitoyable processus de sélection apparaît d'ailleurs clairement dans les statistiques relatives aux effectifs des Lager. A Auschwitz, abstraction faite des autres prisonniers qui vivaient dans des conditions différentes, sur l'ensemble des anciens détenus juifs — c'est-à- dire des kleine Nummer, des petits numéros inférieurs à cinquante mille — il ne restait en 1944 que quelques centaines de survivants :
aucun de ces survivants n'était un Hàftling ordinaire, végétant dans un Kommando ordinaire et se contentant de la ration normale. Il ne restait que les médecins, les tailleurs, les cordonniers, les musiciens, les cuisiniers, les homosexuels encore jeunes et attirants, les amis ou compatriotes de certaines autorités du camp, plus quelques individus particulièrement impitoyables, vigoureux et inhumains, solidement installés (après y avoir été nommés par le commandement SS, qui en matière de choix témoignait d'une connaissance diabolique de l'âme humaine) dans les fonctions de Kapo, Blockâltester ou autre.
Restaient enfin ceux qui, sans occuper de fonctions particulières, avaient toujours réussi grâce à leur astuce et à leur énergie à s'organiser avec succès, se procurant ainsi, outre des avantages matériels et une réputation flatteuse, l'indulgence et l'estime des puissants du camp. Ainsi, celui qui ne sait pas devenir Organisator, Kombinator, Prominent (farouche éloquence des mots !) devient inéluctablement un « musulman ». Dans la vie, il existe une troisième voie, c'est même la plus courante ; au camp de concentration, il n'existe pas de troisième voie.
Le plus simple est de succomber : il suffit d'exécuter tous les ordres qu'on reçoit, de ne manger que sa ration et de respecter la discipline au travail et au camp. L'expérience prouve qu'à ce rythme on résiste rarement plus de trois mois. Tous les « musulmans » qui finissent à la chambre à gaz ont la même histoire, ou plutôt ils n'ont pas d'histoire du tout : ils ont suivi la pente jusqu'au bout, naturellement, comme le ruisseau va à la mer. Dès leur arrivée au camp, par incapacité foncière, par malchance, ou à la suite d'un incident banal, ils ont été terrassés avant même d'avoir pu s'adapter. ( ... )
L'homme qui mourra aujourd'hui devant nous a sa part de responsabilité dans cette révolte. On murmure qu'il était en contact avec les insurgés de Birkenau, qu'il avait apporté des armes dans notre camp, et qu'il voulait organiser ici aussi une mutinerie au même moment. Il mourra aujourd'hui sous nos yeux : et peut-être les Allemands ne comprendront-ils pas que la mort solitaire, la mort d'homme qui lui est réservée, le vouera à la gloire et non à l'infamie.
Quand l'Allemand eut fini son discours que personne ne comprit, la voix rauque du début se fit entendre à nouveau « Habt îhr verstanden » (Est-ce que vous avez compris )
Qui répondit « Jawohl » ? Tout le monde et personne; ce fut comme si notre résignation maudite prenait corps indépendamment de nous et se muait en une seule voix au- dessus de nos têtes. Mais tous nous entendîmes le cri de celui qui allait mourir, il pénétra la vieille gangue d'inertie et de soumission et atteignit au vif l'homme en chacun de nous.
« Kameraden, ich bin der letzte » (Camarades, je suis le Dernier)
Je voudrais pouvoir dire que de notre masse abjecte une voix se leva, un murmure, un signe d'assentiment mais il ne s'est rien passé. Nous sommes restes debout, courbes et gris, tête baissée, et nous ne nous sommes découverts que lorsque l'Allemand nous en a donné l'ordre. La trappe s'est ouverte, le corps a eu un frétillement horrible, la fanfare a recommencé a jouer, et nous, nous nous sommes remis en rang et nous avons défilé devant les derniers spasmes du mourant.
Au pied de la potence, les SS nous regardent passer d'un œil indifférent, leur œuvre est finie, et bien finie. Les Russes peuvent venir, désormais il n'y a plus d'hommes forts parmi nous, le dernier pend maintenant au-dessus de nos têtes, et quant aux autres, quelques mètres de corde ont suffi. Les Russes peuvent bien venir ils ne trouveront plus que des hommes domptes, éteints, dignes désormais de la mort passive qui les attend.
Détruire un homme est difficile, presque autant que le créer. Cela n'a été ni aise ni rapide, mais vous y êtes arrives, Allemands. Nous voici dociles devant vous, vous n'avez plus rien à craindre de nous ni les actes de révolte, ni les paroles de défi, ni même un regard qui vous juge.
" Si c'est un homme " par Primo Levi ( PDF)
http://gen.lib.rus.ec/foreignfiction/index.php?s=Primo+Levi&f_lang=French&f_columns=0&f_ext=All
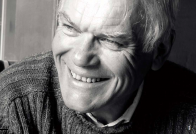






































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire