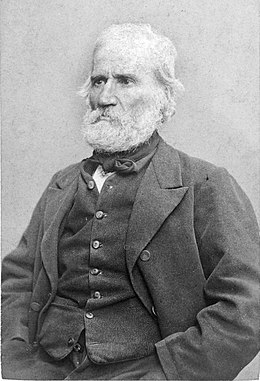D'autre part, un phénomène très étrange apparaît et se confirme : tous les politiques, dans tous les régimes, se prononcent sans réserve pour la croissance. Avec des raisons diverses selon les régions et les idéologies, mais toujours bonnes. Je ne veux pas ici parler de tous ceux qui s'intéressent à la politique, mais des hommes qui sont dans les institutions, celles du pouvoir.
Il y a peu de temps les pays capitalistes avancés, ou plutôt leurs dirigeants, présentaient un tableau idyllique de la situation économique, malgré quelques ombres qui d'ailleurs s'effaceraient vite, disaient-ils. La croissance pouvait et devait être indéfinie. On la concevait telle, au moins virtuellement. Sauf erreur grave de la part des politiques, pensaient les économistes, le processus de la croissance pouvait tendre vers une courbe exponentielle. Vous savez ce que cela veut dire. La croissance économique se confondait avec une croissance mathématique. Cette croissance était toujours considérée comme quantifiable, comme chiffrable (en tonnes d'acier ou de ciment en barils de pétrole, en unités d'autos ou de navires, etc.). L'aspect quantitatif de la croissance passait pour « positif », au sens le plus fort du terme. (...)
Dans cette mise en perspective, les difficultés de la croissance se situaient au début, dans la période que les marxistes appellent : période de l'accumulation primitive. C'était la fameuse théorie du « take off » — démarrage — de Rostow, l'économiste américain, conseiller réactionnaire de la Maison Blanche. Tout au plus, pouvait-il y avoir ici ou là quelque goulot d'étranglement. L'avenir s'ouvrait largement. Aux techniciens et technocrates de prendre les décisions qui engagent ou plutôt ménagent cet avenir.
Technologie et croissance passaient pour complémentaires l'une de l'autre ; les ordinateurs garantissaient et parachevaient ce processus virtuellement harmonieux, et le gigantisme ne faisait peur à personne, ni celui des entreprises, ni celui des projets, ni celui des stratégies. Au contraire : le gigantisme séduisait, passait pour un critère d'avenir.
Or, voici qu'en très peu de temps, un changement extraordinaire s'est produit : un tableau plus que noir, un tableau tragique se déploie devant nous. Certains vont jusqu'à présenter un nouveau millénarisme. Les échéances s'accumulent ; elles ont une sorte de caractère cumulatif, de sorte que l'an 2000 ne verrait pas seulement la fin d'un monde, mais la fin du monde. Lorsque Stanley Kubrick intitulait son film « 2001 », c'est ce qu'il voulait dire. Passera-t-on le cap de l'an 2000 ? Une idéologie apocalyptique a remplacé en très peu de temps l'ancien optimisme. A tel point qu'on voit apparaître par-ci par-là des théories cycliques du temps ; une vision « catastrophale » remplace l'ancienne idéologie du temps historique, du progrès de l'histoire rationnelle, ayant un sens et une finalité évidents.
Énumérons rapidement les échéances. Ce qu'on appelle la pollution, l'environnement, n'est qu'un masque idéologique ; en particulier, le terme « environnement » n'a aucun sens précis ; c'est tout et ce n'est rien, la nature entière et les banlieues. La pollution, la crise de l'environnement, ne sont que la surface de phénomènes plus profonds, parmi lesquels le déchaînement d'une technologie incontrôlée ; le danger signalé par le rapport maintenant fameux du M.I.T. (Massachussetts Institute of Technology), c'est l'épuisement des ressources en fonction de la technologie incontrôlée et de la démographie galopante.
On a vu surgir des concepts singuliers. par exemple : la soft-technology, technologie qui ne brutaliserait pas la nature. l'artisanat technologique. On a vu apparaître le « shrinkmanship » (art du rétrécissement), visant à réduire les dimensions des entreprises, à obtenir la miniaturisation, surtout celle des risques. Le gigantisme était la marque d'un esprit d'entreprise audacieux. Maintenant, c'est le contraire qui va prévaloir. Un projet pour être pris en considération, doit être petit et précis. C'est le lieu de rappeler que des savants éminents ont pris pour seul mot d'ordre, pour seul programme : « survivre ». Et on a pu lire dans le Monde récemment que les gauchistes ont peut-être tort, mais que les hippies ont raison : ils ont établi que la productivité ne fait pas la qualité de la vie...(...)
Si nous examinons maintenant le XIXème siècle finissant et le début du XXème, si nous essayons de décrire les résultats de cette poussée aveugle, nous pouvons dire à peu près ceci :
1 - Le monde de la marchandise se déploie, en liaison étroite avec l'accroissement de la productivité industrielle, et absorbe ce qu'il y avait avant lui ; le marché mondial se constitue.
2 - L'impérialisme, qui soumet par la force tout ce qui existe dans le monde aux exigences du marché et de la production capitaliste (matières premières, investissements de capitaux, etc.), s'ensuit.
3 - Un ensemble de contradictions en résulte, avec les crises cycliques dont Marx a fait la théorie, qui reviennent régulièrement et qui produisent notamment des conjonctures de guerre. Il ne faut jamais oublier que la première guerre mondiale correspond à une crise cyclique et que la montée du fascisme, puis la deuxième guerre mondiale, correspondent aussi à une grande crise cyclique. Les crises cycliques et les guerres ont le même résultat : liquider des excédents (de choses et d'hommes).
Un mélange curieux d'idéologies accompagne la poussée aveugle du capitalisme. Les idéologies se montrent déjà pluri ou multi-fonctionnelles. Elles cachent la réalité, c'est-à-dire le caractère brutal de la poussée économique, de l'expansion capitaliste. Elles comblent certains champs ou certains points aveugles particulièrement gênants et semblent même éclairer l'avenir. Elles dissimulent les contradictions, et même les font apparemment disparaître, masquant dans une large mesure leurs propres contradictions en tant qu'idéologies. Enfin, elles préparent le chemin de l'expansion, sans rapport apparent avec la croissance et le profit.
Troisièmement, à travers leurs propres difficultés, les bourgeoisies ont gagné un haut degré de conscience politique et d'habileté manoeuvrière. Elles sont assez habiles pour tenter d'absorber la pensée marxiste elle-même. Elles ont dès lors une stratégie encore capable d'offensive ; et c'est, après le fascisme, le néo-capitalisme, le néo-impérialisme. Dans cette stratégie, la croissance joue un rôle de plus en plus grand et d'ailleurs inédit : elle se base sur le marché intérieur, et de plus en plus. Cette stratégie est tout à fait délibérée dans un pays comme le Japon, ce qui explique les taux de croissance exceptionnels. Bien entendu, aucune bourgeoisie au pouvoir ne renonce à trouver ailleurs, dans les pays peu développés, des sources de main-d'oeuvre et de matières premières, des débouchés, des territoires d'investissement ; mais la croissance basée sur le marché intérieur joue un rôle déterminant. Dans ces conditions, cette croissance se connaît et se reconnaît elle-même ; elle se connaît et se reconnaît à la fois comme fin et moyen, fin et moyen se confondant, le moyen devenant but et fin.
La croissance porte dès lors en elle sa propre idéologie. Il semble qu'il y ait une logique de la croissance, et sa stratégie se confond avec l'idéologie. La croissance se dit nécessaire, déterminée ; elle se prévoit mathématiquement. On en construit de multiples modèles. L'important, c'est ici de souligner que la croissance ainsi connue et reconnue cherche la cohérence ; d'où l'importance, à partir d'une certaine date, de cette notion et la venue d'un véritable fétichisme de la cohérence. La cohérence recherchée, c'est celle qui éliminerait de la pratique sociale toutes les contradictions. Le curieux, l'étrange, c'est qu'alors la science devient idéologique, notamment l'économie politique. Qu'arrive-t-il ? On agit d'une manière tout à fait conséquente, on va jusqu'au bout pour maintenir la croissance. La destruction devient alors inhérente au capitalisme et cela sur toute la ligne. Pas seulement dans la violence déclarée, civile ou militaire. Pourtant on organise l'obsolescence des objets, c'est-à-dire que la durée des objets, des produits industriels, est abrégée volontairement.
La théorie de l'obsolescence donne lieu à des calculs mathématiques ; il y a une démographie des objets qui chiffre l'espérance de vie de n'importe quel produit et le marché s'organise en fonction de l'espérance de vie des objets. Toutes les « espérances » sont calculées, et pour tout objet : automobile (deux ou trois ans), salle de bains (une dizaine d'années). La science est affectée d'un caractère de mort ; elle calcule la mort des choses et la mort des hommes, sur le modèle des tables dont se servent les compagnies d'assurance. Toutes les données du capitalisme fonctionnent sur des tables de mortalité. C'est un élément essentiel du système.
L'usure morale des machines est expressément voulue ; l'outillage est remplacé avant d'être matériellement usé ; il y a détérioration intense du capital fixe, attribuée au progrès technique, et c'est précisément une fonction du progrès technique que de détruire du capital fixe, sans compter bien entendu les destructions des guerres, la destruction de la nature elle-même. Cela, l'idéologie de la croissance le masque avec soin et elle peut le masquer : l'élément négatif n'est plus en dehors du capitalisme. il est dans son propre sein.
Pendant la même période, l'armement entre dans la production pour la croissance. La paix cesse de se distinguer de la guerre. Insidieux ou brutal, le torrent de la production pour la production avance. Le négatif ? Il n'est plus, disons-nous, hors du processus, dans ses arrêts, ses crises. Il est en lui, la destruction devenant inhérente à la production, immanente. Ce qui la dissimule et laisse croire à l'absence de crise !
2 - Les intellectuels ont admis, accepté la situation nouvelle en lui Cherchant un nom ; d'où les dénominations diverses déjà mentionnées : société technicienne, société de consommation, société de loisirs (la pire des mystifications). Leur critique devint alors moralisante et esthétique. Elle a cessé de porter sur l'essentiel ; elle a porté sur la laideur, la méchanceté, la pauvreté...
3 - Le plus grave peut-être, sur ce point précis, ce fut, c'est la rationalisation et la systématisation, en la faisant apparaître à la fois comme motivée, suivant certains schémas de causalité, et comme close. C'est là où j'incrimine la pensée et les ouvrages de H. Marcuse. Sa théorisation est celle du fait accompli. La mise en forme théorique opérée par Marcuse part du rôle de la connaissance dans la croissance capitaliste ; il l'analyse correctement en se bornant au capitalisme américain ; il reste entendu pour lui que la cohérence est atteinte ; il montre à l'ouvre une rationalité immanente, ravageuse mais efficace, qui réussit à rendre « l'homme » unidimensionnel, et qui ferme le système.
La capacité intégrative du savoir parvient d'après lui à priver simultanément la bourgeoisie et la classe ouvrière de tout rôle historique, de toute possibilité de transformation (qualitative). Face à face, elles se neutralisent, toute opposition entre la vie publique et la vie privée, les besoins individuels et les besoins sociaux tombant en raison du progrès technologique. Le « positif » triomphe du négatif. Le « système omniprésent » qui stabilise la société entière surclasse le mode de production capitaliste mais en même temps l'achève, mises à part quelques fissures par lesquelles fusent les protestations des désespérés. Au lieu de montrer des failles au sein de cette cohérence, des lacunes destinées à s'agrandir, Marcuse a insisté sur la logique interne, venue de l'application du savoir à la pratique sociale du capitalisme. Dans ces conditions, si les centres capitalistes sont solides, puissants, logiques et destinés à croître, d'où peut venir une contre-offensive ? Ou bien elle n'aura pas lieu, ou bien elle viendra des périphéries !
D'autre part, un phénomène très étrange apparaît et se confirme : tous les politiques, dans tous les régimes, se prononcent sans réserve pour la croissance. Avec des raisons diverses selon les régions et les idéologies, mais toujours bonnes. Je ne veux pas ici parler de tous ceux qui s'intéressent à la politique, mais des hommes qui sont dans les institutions, celles du pouvoir. Évidemment, les raisons que l'on peut donner pour maintenir la croissance ne sont pas les mêmes dans les pays dits mal développés, autrefois ou encore dépendants, et les grands pays industriels. Les raisons données par les politiques dans les pays dépendants sont certainement « meilleures ». Il n'en reste pas moins que la quasi-totalité des politiques se prononce pour la croissance dans les pays qu'ils contrôlent, en refusant de tenir compte des graves implications et conséquences ! D'où une situation à propos de laquelle le mot « paradoxe » est faible.
Certains groupes dits « gauchistes » casseraient volontiers la croissance. risquant le retour à l'archaïque et la dislocation de la totalité sociale, et cela en continuant à miser sur les seules périphéries. Quant au mouvement communiste et socialiste, il a toujours misé sur le global, sur le central. Conservateur à sa manière, ce mouvement se propose de maintenir la croissance et se dit seul habilité à la maintenir. En somme, socialistes et communistes, en- Europe, proposent seulement de prendre le relais de la bourgeoisie dans la croissance, bien qu'ils divergent sur les modalités d'exécution. Pour eux, la critique de la croissance ne représente qu'un malthusianisme généralisé (à tous points de vue : démographique, technologique, économique).
Quant à la bourgeoisie et au capitalisme, ils flottent, comme on sait entre l'euphorie et le nihilisme : ils pressentent les difficultés de la croissance indéfinie pour les avoir expérimentées ; ils promettent qu'ils maintiendront la croissance mais sans confiance dans l'avenir. Leurs sautes d'humeur sont continues.
À travers la problématique de la croissance, ce sont donc des idéologies nouvelles qui s'affrontent. En essayant d'écarter le voile des idéologies, on peut cependant affirmer que la croissance indéfinie est impossible et que cette thèse, celle de sa poursuite indéfinie, est elle-même une idéologie. S'il se vérifie qu'une crise globale menace les centres, la situation pratique et théorique donne tort à ces courants qu'on appelle « gauchistes » alors qu'ils ont raison de dénoncer les méfaits de la croissance et de son idéologie. Dans ces conditions peut-il s'agir seulement de prendre la relève de la bourgeoisie pour retrouver les mêmes problèmes ? Non. Il faut trouver autre chose. On peut proposer
1 - une stratégie qui rassemblerait les éléments périphériques avec ceux des centres en difficulté, c'est-à-dire avec les éléments de la classe ouvrière qui se délivreront de l'idéologie de la croissance ;
2 - une orientation de la croissance vers les besoins spécifiquement sociaux et non plus vers les besoins individuels, orientation qui impliquerait la limitation progressive de cette croissance et qui éviterait soit de la casser brutalement, soit de la prolonger indéfiniment. On sait par ailleurs que ces besoins sociaux qui, d'après Marx, définissent un *mode de production socialiste, sont de plus en plus urbains et relatifs à la production ainsi qu'à la gestion de l'espace.
3 - un projet complet et détaillé portant sur l'organisation de la vie et de l'espace en y faisant la plus large part à l'autogestion, mais en sachant que l'autogestion pose autant de problèmes qu'elle en résout.
Un tel projet global, voie plutôt que programme, que plan ou modèle, porte sur la vie collective et ne peut être qu'œuvre collective, simultanément pratique et théorie. il ne peut dépendre ni d'un parti, ni d'un « bloc » politique, mais ne peut s'attacher qu'à un ensemble, diversifié, qualitatif, de mouvements, de revendications, d'actions.
Conférence prononcée à Alger, le 17 mai 1972