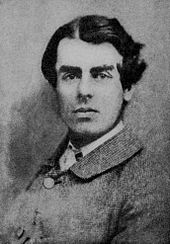L’Américain moyen consacre plus de mille six cents heures par an à sa voiture. Il y est assis, qu’elle soit en marche ou à l’arrêt ; il la gare ou cherche à le faire ; il travaille pour payer le premier versement comptant ou les traites mensuelles, l’essence, les péages, l’assurance, les impôts et les contraventions. De ses seize heures de veille chaque jour, il en donne quatre à sa voiture, qu’il l’utilise ou qu’il gagne les moyens de le faire. (…) S’il exerce une activité professionnelle, l’Américain moyen dépense mille six cents heures chaque année pour parcourir dix mille kilomètres ; cela représente à peine 6 kilomètres à l’heure.
Aujourd’hui il est devenu inévitable de parler d’une crise de l’énergie qui nous menace. Cet euphémisme cache une contradiction et consacre une illusion. Il masque la contradiction inhérente au fait de vouloir atteindre à la fois un état social fondé sur l’équité et un niveau toujours plus élevé de croissance industrielle. Il consacre l’illusion que la machine peut absolument remplacer l’homme. Pour élucider cette contradiction et démasquer cette illusion, il faut reconsidérer la réalité que dissimulent les lamentations sur la crise : en fait, l’utilisation de hauts quanta d’énergie a des effets aussi destructeurs pour la structure sociale que pour le milieu physique. Un tel emploi de l’énergie viole la société et détruit la nature.
Les avocats de la crise de l’énergie défendent et répandent une singulière image de l’homme. D’après leur conception, l’homme doit se soumettre à une continuelle dépendance à l’égard d’esclaves producteurs d’énergie qu’il lui faut à grand-peine apprendre à dominer. Car, à moins d’employer des prisonniers pour ce faire, l’homme a besoin de moteurs auxiliaires pour exécuter la plus grande partie de son propre travail. Ainsi le bien-être d’une société devrait se mesurer au nombre de tels esclaves que chaque citoyen sait commander. Cette conviction est commune aux idéologies opposées qui sont en vogue à présent. Mais sa justesse est mise en doute par l’inéquité, les tourments et l’impuissance partout manifestes, dès lors que ces hordes voraces d’esclaves dépassent d’un certain degré le nombre des hommes. Les propagandistes de la crise de l’énergie soulignent le problème de la pénurie de nourriture pour ces esclaves. Moi, je me demande si des hommes libres ont vraiment besoin de tels esclaves. (…)
L’Américain moyen consacre plus de mille six cents heures par an à sa voiture. Il y est assis, qu’elle soit en marche ou à l’arrêt ; il la gare ou cherche à le faire ; il travaille pour payer le premier versement comptant ou les traites mensuelles, l’essence, les péages, l’assurance, les impôts et les contraventions. De ses seize heures de veille chaque jour, il en donne quatre à sa voiture, qu’il l’utilise ou qu’il gagne les moyens de le faire. Ce chiffre ne comprend même pas le temps absorbé par des activités secondaires imposées par la circulation : le temps passé à l’hôpital, au tribunal ou au garage, le temps passé à étudier la publicité automobile ou à recueillir des conseils pour acheter la prochaine fois une meilleure bagnole. Presque partout on constate que le coût total des accidents de la route et celui des universités sont du même ordre et qu’ils croissent avec le produit social. Mais, plus révélatrice encore, est l’exigence de temps qui s’y ajoute. S’il exerce une activité professionnelle, l’Américain moyen dépense mille six cents heures chaque année pour parcourir dix mille kilomètres ; cela représente à peine 6 kilomètres à l’heure. Dans un pays dépourvu d’industrie de la circulation, les gens atteignent la même vitesse, mais ils vont où ils veulent à pied, en y consacrant non plus 28 %, mais seulement 3 à 8 % du budget-temps social. Sur ce point, la différence entre les pays riches et les pays pauvres ne tient pas à ce que la majorité franchit plus de kilomètres en une heure de son existence, mais à ce que plus d’heures sont dévolues à consommer de fortes doses d’énergie conditionnées et inégalement réparties par l’industrie de la circulation.
Passé un certain seuil de consommation d’énergie, l’industrie du transport dicte la configuration de l’espace social. La chaussée s’élargit, elle s’enfonce comme un coin dans le cœur de la ville et sépare les anciens voisins. La route fait reculer les champs hors de portée du paysan mexicain qui voudrait s’y rendre à pied. Au Brésil, l’ambulance fait reculer le cabinet du médecin au-delà de la courte distance sur laquelle on peut porter un enfant malade. A New York, le médecin ne fait plus de visite à domicile, car la voiture a fait de l’hôpital le seul lieu où il convienne d’être malade. Dès que les poids lourds atteignent un village élevé des Andes, une partie du marché local disparaît. Puis, lorsque l’école secondaire s’installe sur la place, en même temps que s’ouvre la route goudronnée, de plus en plus de jeunes gens partent à la ville, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus une seule famille qui n’espère rejoindre l’un des siens, établi là-bas, sur la côte, à des centaines de kilomètres. (…)
Du temps de Cyrus à celui de la machine à vapeur, la vitesse de l’homme est restée la même. Quel que fût le porteur du message, les nouvelles ne franchissaient pas plus de 150 kilomètres par jour. Ni le coureur inca, ni la galère vénitienne, ni le cavalier persan, ni la diligence de Louis XIV n’ont pu rompre cette barrière. Guerriers, explorateurs, marchands ou pèlerins couvraient 30 kilomètres par jour. Comme le dit Valéry : « Napoléon va à la même lenteur que César. » L’Empereur savait qu’« on mesure la prospérité publique aux comptes des diligences », mais il ne pouvait guère presser le mouvement. De Paris à Toulouse, on mettait deux cents heures à 1’époque romaine, et encore cent cinquante-huit heures avec la diligence en 1782. Le XIXe siècle a, le premier, accéléré le mouvement des hommes. (…)
Le roulement à billes a été inventé il y a un siècle. Grâce à lui le coefficient de frottement est devenu mille fois plus faible. En ajustant convenablement un roulement à billes entre deux meules néolithiques, un Indien peut moudre à présent autant de grain en une journée que ses ancêtres en une semaine. Le roulement à billes a aussi rendu possible l’invention de la bicyclette, c’est-à-dire l’utilisation de la roue, - la dernière, sans doute, des grandes inventions néolithiques -, au service de la mobilité obtenue par la force musculaire humaine. Le roulement à billes est ici le symbole d’une rupture définitive avec la tradition et des directions opposées que peut prendre le développement.
L’homme peut se déplacer sans l’aide d’aucun outil. Pour transporter chaque gramme de son corps sur un kilomètre en dix minutes, il dépense 0,75 calorie. Il forme une machine thermodynamique plus rentable que n’importe quel véhicule à moteur et plus efficace que la plupart des animaux. Proportionnellement à son poids, quand il se déplace, il produit plus de travail que le rat ou le bœuf, et moins que le cheval ou l’esturgeon. Avec ce rendement, il a peuplé la terre et fait son histoire. A ce même niveau, les sociétés agraires consacrent moins de 5 % et les nomades moins de 8 % de leur budget-temps à circuler hors des habitations ou des campements.
A bicyclette, l’homme va de trois à quatre fois plus vite qu’à pied, tout en dépensant cinq fois moins d’énergie. En terrain plat, il lui suffit alors de dépenser 0,15 calorie pour transporter un gramme de son corps sur un kilomètre. La bicyclette est un outil parfait qui permet à l’homme d’utiliser au mieux son énergie métabolique pour se mouvoir : ainsi outillé, l’homme dépasse le rendement de toutes les machines et celui de tous les animaux. (…)
La libération du monopole radical de l’industrie, le choix joyeux d’une technique « pauvre » sont possibles là où les gens participent à des procédures politiques fondées sur la garantie d’une circulation optimale. Cela exige qu’on reconnaisse l’existence de quanta d’énergie socialement critiques, dont l’ignorance a permis la constitution de la société industrielle. Ces quanta d’énergie conduiront ceux qui consomment autant, mais pas plus, à l’âge post-industriel de la maturité technique.
Cette libération ne coûtera guère aux pauvres, mais les riches payeront cher. Il faudra bien qu’ils en payent le prix si l’accélération du système de transport paralyse la circulation. Ainsi une analyse concrète de la circulation révèle la vérité cachée de la crise de l’énergie : les quanta d’énergie conditionnés par l’industrie ont pour effets l’usure et la dégradation du milieu, l’asservissement des hommes. Ces effets entrent en jeu avant même que se réalisent les menaces d’épuisement des ressources naturelles, de pollution du milieu physique et d’extinction de la race. Si l’accélération était démystifiée, alors on pourrait choisir à l’est comme à l’ouest, au nord comme au sud, en ville comme à la campagne, d’imposer des limites à l’outil moderne, ces limites en deçà desquelles il est un instrument de libération.
http://carfree.free.fr/index.php/2008/02/03/energie-et-equite-1973/