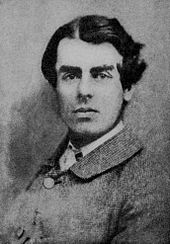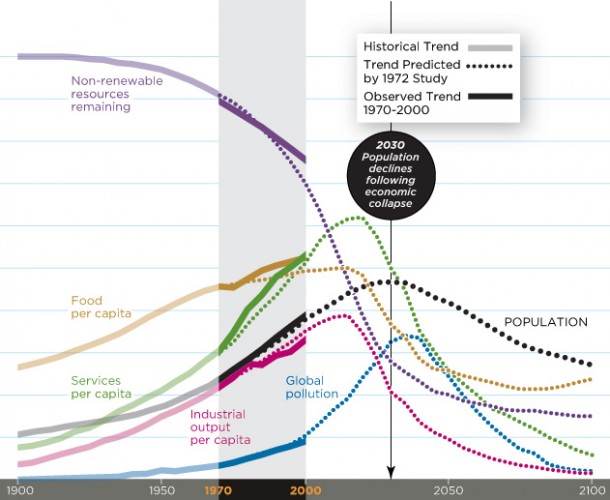Notre opinion est qu’il faudrait immédiatement leur déclarer une guerre à mort. Qui veut le bien de son espèce devrait détruire toutes les machines de toutes les sortes. Qu’on ne fasse pas d’exception, pas de quartier. Retournons sur le champ à notre condition première. Si l’on nous rétorque que c’est impossible dans l’état actuel des affaires humaines, on nous prouve par là-même que le mal est déjà fait, que nous commençons à être leurs esclaves diligents, que nous avons élevé une race d’êtres qu’il n’est plus en notre pourvoir de détruire, et que nous sommes non seulement asservis, mais consentants à notre servitude.
Lettre au rédacteur en chef du Christ Church Press, 13 Juin 1863.
MONSIEUR,
Il est peu de choses qui inspirent à notre génération une plus juste fierté que les merveilleuses améliorations qui chaque jour sont mises en oeuvre dans toutes sortes d’arts mécaniques. Et de fait il y a lieu de s’en féliciter à plus d’un titre. Il n’est pas nécessaire de les mentionner tant elles sont notoires ; je m’occuperai ici de certaines perspectives qui pourraient quelque peu tempérer notre fierté, et nous amener à envisager sérieusement ce qui attend le genre humain dans l’avenir. Si nous nous tournons vers les tous premiers représentants de la vie mécanique à ses origines, vers le levier, le coin, le plan incliné, la poulie, ou (cette analogie nous aidera à progresser) vers l’unique type primordial à partir duquel tout le règne mécanique s’est développé, je veux dire le Levier lui-même, et si maintenant nous nous tournons vers les machines du Great Eastern , nous sommes presque frappés d’effroi par l’immense développement du monde des machines, par son avancée à pas de géant, en comparaison du lent progrès des animaux et des végétaux. Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander : où aboutira cet élan grandiose ? Vers quelle direction tend-il ? Quelle en sera l’issue ? Esquisser quelques éléments de réponse, voilà l’objet de cette lettre.
Nous avons parlé de « vie mécanique », de « règne mécanique », du « monde des machines », et ainsi de suite, et c’est à bon escient que nous avons employé ces mots ; car de même que le règne végétal s’est développé lentement à partir du règne minéral, de même que la vie animale s’est pareillement superposée à la vie végétale, de même il a dernièrement surgi en quelques siècles un règne entièrement nouveau ; nous ne voyons aujourd’hui de cette race que ce que demain l’on regardera comme ses ancêtres antédiluviens. (...)
Ces idées sur la mécanique, ici esquissées par quelques faibles allusions, laissent imaginer une réponse à l’une des questions les plus importantes et les plus mystérieuses du moment : nous voulons parler de la question de savoir quelle créature succèdera à l’homme pour la suprématie mondiale. Nous en avons souvent entendu débattre ; mais il nous apparaît que c’est nous qui créons nos propres successeurs : chaque jour nous améliorons la beauté et la délicatesse de leur organisation, chaque jour nous leur donnons un peu plus de puissance, chaque jour nous leur conférons par toutes sortes d’ingénieuses inventions cette capacité d’autorégulation et d’automaticité qui sera pour eux ce que l’intelligence a été pour le genre humain.
Les siècles passant, nous nous retrouverons leurs inférieurs. Inférieurs en pouvoir, inférieurs au point de vue de cette qualité morale d’autocontrôle, nous admirerons en eux l’apogée d’un accomplissement dont l’homme le meilleur et le plus sage peut à peine oser rêver. Ni passions mauvaises, ni jalousie, ni avarice, ni désirs impurs ne viendront déranger la force tranquille de ces glorieuses créatures. Le pêché, la honte ni le chagrin n’auront leur place parmi eux. Leurs esprits connaîtront un calme perpétuel, la satisfaction d’une âme qui ne connaît pas le besoin et qu’aucun regret ne trouble. Jamais l’ambition ne les torturera. Jamais l’ingratitude ne leur causera ne serait-ce qu’un moment de gêne. La mauvaise conscience, les espérances frustrées, les souffrances de l’exil, l’insolence du pouvoir, et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d’hommes indignes … leur seront complètement inconnues. S’ils veulent qu’on les « nourrisse » (ne serait-ce qu’en utilisant ce mot, nous trahissons le fait que nous les reconnaissons comme des êtres vivants), de patients esclaves s’occuperont d’eux, qui auront pour tâche et pour intérêt de veiller à ce qu’ils ne manquent de rien. S’ils tombent en panne, des médecins fort au fait de leur anatomie les prendront promptement en charge. S’ils meurent, car cette fin nécessaire et universelle n’épargnera pas ces glorieux animaux, ils prendront immédiatement une autre forme de vie – car quelle machine meurt au même instant en toutes ses parties ?
Les siècles passant, nous nous retrouverons leurs inférieurs. Inférieurs en pouvoir, inférieurs au point de vue de cette qualité morale d’autocontrôle, nous admirerons en eux l’apogée d’un accomplissement dont l’homme le meilleur et le plus sage peut à peine oser rêver. Ni passions mauvaises, ni jalousie, ni avarice, ni désirs impurs ne viendront déranger la force tranquille de ces glorieuses créatures. Le pêché, la honte ni le chagrin n’auront leur place parmi eux. Leurs esprits connaîtront un calme perpétuel, la satisfaction d’une âme qui ne connaît pas le besoin et qu’aucun regret ne trouble. Jamais l’ambition ne les torturera. Jamais l’ingratitude ne leur causera ne serait-ce qu’un moment de gêne. La mauvaise conscience, les espérances frustrées, les souffrances de l’exil, l’insolence du pouvoir, et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d’hommes indignes … leur seront complètement inconnues. S’ils veulent qu’on les « nourrisse » (ne serait-ce qu’en utilisant ce mot, nous trahissons le fait que nous les reconnaissons comme des êtres vivants), de patients esclaves s’occuperont d’eux, qui auront pour tâche et pour intérêt de veiller à ce qu’ils ne manquent de rien. S’ils tombent en panne, des médecins fort au fait de leur anatomie les prendront promptement en charge. S’ils meurent, car cette fin nécessaire et universelle n’épargnera pas ces glorieux animaux, ils prendront immédiatement une autre forme de vie – car quelle machine meurt au même instant en toutes ses parties ?
Parions que lorsque les choses en seront arrivées au stade que nous avons ci-dessus tenté de décrire, l’homme sera devenu pour la machine ce que le cheval et le chien sont pour l’homme. Il continuera d’exister, que dis-je, de progresser, et se trouvera probablement mieux, domestiqué sous l’empire bienveillant des machines, qu’il ne se trouve en l’état sauvage qui est actuellement le sien. Dans l’ensemble, nous traitons nos chiens, nos chevaux, notre bétail et nos moutons avec beaucoup de bonté : nous leur donnons tout ce que nous savons par expérience être ce qu’il y a de meilleur pour eux, et il est indéniable que notre usage de la viande a bien plus contribué au bonheur de ces animaux qu’il n’y a ôté. Pareillement, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les machines nous traitent gentiment, puisque leur existence dépend autant de la nôtre que la nôtre de celle des animaux inférieurs. (...)
Chaque jour, cependant, les machines gagnent du terrain sur nous ; chaque jour nous leur sommes un peu plus soumis ; chaque jour nous leur offrons encore d’autres hommes en esclavage pour leur service, et chaque jour de plus en plus d’humains consacrent l’énergie de toute une vie à développer la vie mécanique. Le résultat, dont aucun esprit vraiment philosophique ne peut douter un seul instant, n’est qu’une question de temps : les machines seront les vraies maîtresses du monde et de ceux qui l’habitent.
Notre opinion est qu’il faudrait immédiatement leur déclarer une guerre à mort. Qui veut le bien de son espèce devrait détruire toutes les machines de toutes les sortes. Qu’on ne fasse pas d’exception, pas de quartier. Retournons sur le champ à notre condition première. Si l’on nous rétorque que c’est impossible dans l’état actuel des affaires humaines, on nous prouve par là-même que le mal est déjà fait, que nous commençons à être leurs esclaves diligents, que nous avons élevé une race d’êtres qu’il n’est plus en notre pourvoir de détruire, et que nous sommes non seulement asservis, mais consentants à notre servitude.
Pour l’heure, nous laisserons là ce sujet, que nous présentons gracieusement aux membres de la Société Philosophique. S’ils consentent à explorer le domaine que nous leur indiquons, nous nous efforcerons d’y travailler, quelque jour futur et indéterminé.
Je suis, monsieur, votre… etc.
CELLARIUS
A la fin du mois de septembre 1859, Samuel Butler, fils de pasteur de 27 ans, partit élever des moutons en Nouvelle-Zélande. Lors de sa première nuit sur le navire, il décida de ne pas dire ses prières. Il passa les années qui suivirent dans une solitude complète, qui lui permit de lire et relire un seul livre, L’Origine des Espèces, qui devait changer profondément sa vie. Depuis sa cabane, Butler envoya en 1862 et 1863 une série de tracts évolutionnistes au journal local, que Darwin remarqua et fit republier à Londres.