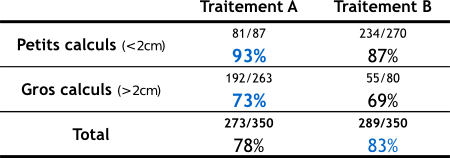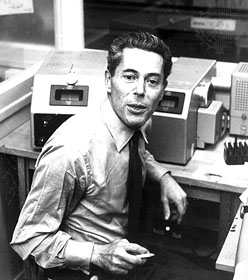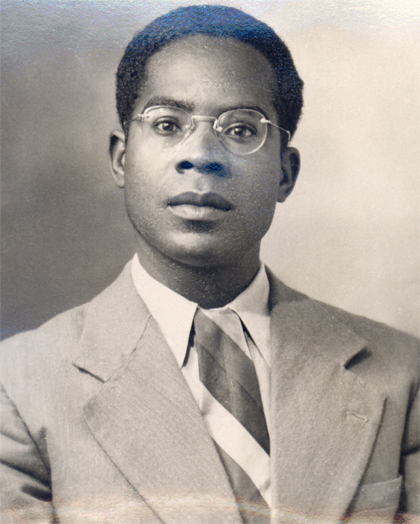Voilà comment la civilisation civilise. Après avoir tué, elle dégrade. Son dernier triomphe est de dissoudre les âmes, avilir les cœurs, démoraliser les caractères. Quand on fusillait les sauvages par tas et que les blessés étaient achevés par les bouledogues, quand le colon massacrait les sauvages, notre sensibilité trouvait à redire. Mais aucun blâme n’est encouru depuis que l’on extermine les noirs par les noirs.
Quand ils arrivaient seuls ou avec une faible escorte, ces messagers de la civilisation gagnaient les cœurs par le charme des discours, par des manières accortes, des yeux riant la douceur et la bonté. Mais quelle terreur inspirait l’arrivée soudaine d’un navire du soleil descendu, d’un prodigieux navire aux énormes voiles blanches, dont le ventre s’ouvrait, livrant passage à une troupe armée, à des sabres luisants, à des chevaux, êtres extraordinaires ! Partout la même histoire. Ces étrangers descendus du ciel, investis d’une puissance terrible, furent pris pour des ancêtres, des divinités de la foudre et de la lumière, adorés et obéis. Que ne furent-ils bons et raisonnables !
Une poignée de cavaliers armés de canons et de tromblons conquirent l’Amérique, précédés qu’ils étaient de l’effrayante nouvelle : « Du pays solaire les dieux arrivent lançant la foudre par la bouche, et montant les coursiers du tonnerre » !
Les Mexicains baisaient la proue du navire qui amenait les Espagnols ; les croyant des Immortels à la suite de Quetzalcoatl, ils leur amenaient de belles Indiennes afin de gagner leurs bonnes grâces. Montezuma vint se prosterner devant les mystérieux étrangers, les teignit de sang, leur sacrifia des victimes, offrit à Cortez un costume complet de dieu. À ce dieu, ils donnèrent le nom d’Astre-Roi, à ses compagnons celui d’Enfants du Soleil. Les domestiques furent titrés de prêtres et grands prêtres.
Mais pourquoi ces êtres divins avaient-ils dévalé des nuages ? On ne soupçonnait leur soif de l’or, mais on avait une peur bleue qu’ils décrétassent la fin du siècle. Au lieu de se mettre en ordre de combat, au lieu de frapper d’estoc et de taille, de tuer, de butiner, pourquoi les Espagnols ne se rendaient-ils pas droit aux temples, s’asseyant sur les trônes pour commander aux peuples agenouillés ? (…)
Nos Australiens ne manquèrent pas non plus de prendre les Européens premier-débarqués pour des Ngamajit au teint d’aurore, des ancêtres qui arrivaient du Pays des Ombres, montés sur un formidable volatile dont les ailes étaient maîtresses des plaines liquides et des espaces célestes. Hippogriffes, que le gouvernail et les amarres. Les canots, autant de petits collés au flanc du monstre. Le premier qui vit l’apparition courut vingt kilomètres d’un trait pour annoncer le prodige. Tout ce qui entourait ces êtres merveilleux semblait effrayant et magique. La lanterne allumée au haut de la tente passait pour un fusil qui fouillait l’obscurité, un pistolet pour l’enfant du fusil. (…)
« Tombe nègre, ressaute blanc », disent les Non-Non australiens dans leur langage pittoresque pour désigner la résurrection. Un pauvre diable qu’un jury de Melbourne trouva bon de pendre, prit la chose gaiement et s’écriait sous la potence : « Très bien, moi sursauter, blanc avec cigares ! » Car les nègres croient ressusciter chez les Blancs, en un pays de cocagne. Habitués à garder la peau de leurs défunts, ils avaient remarqué la blancheur des muscles dépouillés du derme. De là les dénominations d’« écorchés », de « revenants » et de « morts » qu’ils donnaient aux colons. Ils se barbouillent de craie en signe de deuil. Rappelons à ce propos que par toute l’Europe les châteaux historiques sont hantés de Dames blanches, messagères de trépas. Les Bangallas du Congo passeront blancs dans l’autre monde. Les démons Nâts sont blancs chez les Karènes ; aux nègres le diable se montre en semblance de pierrot. (…)
Ainsi, les Primitifs rêvaient justice, bonheur et abondance. Un cygne leur arrivait en messager, un cygne immense nageant parmi les nuées, volant d’horizon en horizon, descendant du ciel et battant de grandes ailes blanches. Des génies arrivaient, hérauts de la parole nouvelle. Montés sur des coursiers-ouragans, ils tenaient en main, qui la foudre, qui l’eau de feu, puisée à la fontaine de Jouvence, pensait-on. Or, ces Messies étaient ce que la Grande-Bretagne avait de mieux en voleurs, banqueroutiers, escarpes, empoisonneurs, chourineurs et autres malandrins, l’exécrable rebut des Trois-Royaumes. Tel fut le premier contact de la civilisation avec les enfants de la nature. (…)
La colonisation se fit sur le principe que la terre australienne étant res nullius — dite en latin l’assertion a grand air et semble indiscutable — ou « la chose de personne », relevait du gouvernement qui, moyennant achat ou redevance, l’attribuait au premier occupant, pourvu que le premier occupant ne fût pas un nègre. La couronne récompensait la bonne conduite des forçats en leur distribuant des bons portant donation de deux à trois hectares. Un convict cabaretier troquait ces bons contre de petits verres et mourut propriétaire à Sydney de quartiers entiers, valant alors une trentaine de millions. Au nom de Victoria, reine de la Grande-Bretagne, l’administration parcelait, concédait le sol à telles et telles conditions, vendait ce qui ne lui avait rien coûté. L’immigrant avançait, l’aumaille augmentait, les noirs disparaissaient.
Sur un si vaste territoire l’aborigène ne regardait pas aux kilomètres carrés ; il accueillait le nouvel arrivant avec bienveillance, ne se lassait pas de regarder cet homme venu de par-delà les nuages avec la foudre dans un roseau, mirait ces énormes quadrupèdes cornus, ces grandes vaches dont on emportait de pleins sceaux de lait ; il jubilait de voir les fringants étalons, les poulains bondissant autour des juments. Tel un ramier, couvant sa nichée dans un eucalypte à cent pieds au-dessus du sol, suit avec intérêt le manège des bûcherons qui attaquent l’arbre immense à coups de hache, tel le nègre naïf insouciant s’amusait à voir l’Européen construire des blocages, enclore des prairies. Les pauvres hères ne pouvaient se désabuser de leur respect pour l’Européen, être supérieur, d’Outre-Bleu descendu ; ne pouvaient se guérir de l’idée que le fusil était un être vivant.
Et si, mourant de faim, irrité par le spectacle des bêtes grasses, l’indigène faisait irruption dans l’enclos et s’adjugeait quelque pièce, cela s’appelait a brigandage » ; acte sévèrement qualifié, sévèrement puni par la loi des blancs, imperturbable dans les distinctions : « Le kangourou, en tant que gibier, est propriété commune, le mouton, en tant que bétail, est propriété privée. » — Commencez par une bonne définition, précisez les termes, établissez que l’argent, le capital du riche, porte intérêt, et que le travail, capital du pauvre, n’en porte pas, le reste ira de soi. La législation obligeait l’indigène à des méfaits qu’elle punissait durement. Quelques articles du code, simples et clairement libellés, constituaient aux bouscassiers bipèdes et forestiers quadrupèdes même état civil et judiciaire. Shakespeare pensait-il à la spoliation du sauvage par le civilisé quand il fait parler « Caliban aux cheveux hérissés » :
« Lorsque tu abordas, tu me caressais, me faisais mamours, tu me donnais des mures trempées dans l’eau. Je t’aimais alors, je te montrais les beaux endroits, les sources fraîches et les puits salés, les lieux arides et les régions fertiles. Cette île m’appartient et tu me l’as volée ! »
— « Être de basse et perverse origine ! Repaire immonde de tous les vices ! » répond Prospéro pour toute justification.
Le colon qui veut transformer une forêt en moutonnerie, n’a pas la simplicité de s’attaquer hache en main aux eucalyptes géants ; il enlève à hauteur commode un cercle d’écorce sur les troncs. L’opération, dite du ceinturage, tranche la communication entre les vaisseaux de sève montante et les vaisseaux souterrains ; l’arbre dépérit et meurt. Les grands squelettes blanchis tendent vers le ciel de longs bras décharnés ; le vent entrechoque les ramures avec un bruit sec d’ossements. Il suffit alors d’une allumette dans un amas de ramée et de feuilles sèches, pour réduire en cendres l’œuvre qui coûta plusieurs siècles à la Nature. Aux pigeons, aux tisserins de prendre vol, à tous sylvestres de trouver à vivre par ailleurs. (…)
Si bien que, tourmentés par la famine dans le terrible été de 1876-77, les Birrias et les Koungariditches dont les blancs avaient accaparé le meilleur du territoire en arrivèrent à manger leurs enfants. Se figurant les blancs solidarisés en castes ou tribus, ces imbéciles se vengeaient d’un Européen sur le premier Européen venu. Déraison intolérable, crime abominable des noirs, qu’on punissait par des massacres.
« Les sauvages ont perpétré de nouveaux attentats, leurs actes inhumains ont encore soulevé l’indignation des hommes de cœur... Il serait grand temps qu’une répression sérieuse mît un terme à ces crimes dignes des démons... »
Amener ces malfaiteurs devant un tribunal, les livrer à la basoche, on s’y essaya, mais la bouffonnerie ne prit pas. Les brutes ne s’y prêtaient d’aucune façon ; il fut impossible de leur faire rien comprendre à notre institution justiciaire, dans laquelle « la forme emporte le fond », pour parler comme le grand jurisconsulte Philippe Dupin. Technique, toujours technique, et rien que technique, elle n’a que faire de la conscience, met l’équité sous ses pieds. Après quelques procédures grotesques, il n’y eut qu’à mettre les indigènes hors la loi, les déclarant incapables « d’ester en justice et de posséder arme à feu ». Assimilés au dingo pillard, ils jouissaient à peu près des mêmes droits politiques et civils. Un grand juge de Tasmanie — en ces affaires la Tasmanie donnait le ton et prêchait d’exemple — avait décidé :
« Que le natif, même l’ancien habitant, avait à vider les parages d’une concession faite par la Couronne. Que tout colon pouvait considérer comme preuve suffisante d’un brigandage commis ou à commettre, la présence d’un nègre sur sa propriété, et qu’il avait tous droits de se prémunir contre une attaque présumée. »
Habitués à ne voir que des hommes à cheval, les bestiaux des parages s’inquiètent quand ils flairent le nègre, s’épouvantent à son approche. L’indigène ne peut donc se montrer sans porter tort à la propriété du blanc. Recevoir à coups de fusil cet intrus, malfaiteur possible ou probable, n’excédait pas les droits de légitime défense. Devant le tribunal de Sydney l’avocat Wardel établit de par Baronius, Puffendorf et Barbeyrac que : « les naturels sont proscrits par la loi naturelle. Les tuer n’est pas crime. Ces anthropophages il faut les exterminer par raison d’utilité publique. Ils mangent des chiens putréfiés et boivent, — boivent ? non, ils Jappent — l’eau des fossés infects, déshonorent l’humanité par des manières bestiales ». Sur ce thème on brodait à plaisir ; rien ne semblait trop bizarre, trop étrange ou monstrueux. On hait ceux qu’on connaît mal ; on abomine ceux qu’on ne veut pas connaître. « Ces chimpanzés, descendez-les sans regret ! » imprimait un journal de Port-Jackson.
Les gazettes de Sydney expliquaient : « Fauves ou aborigènes, c’est tout un. Vous les dites inoffensifs ? Qu’on les laisse dépérir par la diminution de leurs moyens de subsistance. Vous les dites féroces ! Qu’on les supprime ! »
Voilà comment la civilisation civilise. Après avoir tué, elle dégrade. Son dernier triomphe est de dissoudre les âmes, avilir les cœurs, démoraliser les caractères. Quand on fusillait les sauvages par tas et que les blessés étaient achevés par les bouledogues, quand le colon massacrait les sauvages, notre sensibilité trouvait à redire. Mais aucun blâme n’est encouru depuis que l’on extermine les noirs par les noirs. Voire, le gouvernement mérita l’éloge de nos philanthropes quand il institua une fonction nouvelle, celle du « protectorat des indigènes » et qu’il paya sur la caisse publique une douzaine de plumitifs avec carte blanche pour libeller tous griefs, appels, remontrances et protestations, avec les pouvoirs les plus étendus pour calligraphier tous mémoires, considérants, protocoles, et grossir la paperasse qui s’amoncelle dans la chancellerie aux larges armoires.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ÉLIE RECLUS
- ÉLIE RECLUS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-