Un monde sans profs ou dockers serait bien vite en difficulté, et même un monde sans auteur de science fiction ou musicien de ska serait clairement un monde moins intéressant. Ce n’est pas complètement clair comment le monde souffrirait de la disparition des directeurs généraux d’entreprises, lobbyistes, chercheurs en relation presse, télémarketeurs, huissiers de justice ou consultant légaux (Beaucoup soupçonnent même que la vie s’améliorerait grandement).
Dans les années 30, John Maynard Keynes avait prédit que, à la fin du siècle, les technologies seront suffisamment avancées pour que des pays comme le Royaume Uni ou les Etats Unis envisagent des temps de travail de 15 heures par semaine. Il y a toutes les raisons de penser qu’il avait raison. Et pourtant cela n’est pas arrivé. Au lieu de cela, la technologie a été manipulée pour trouver des moyens de nous faire travailler plus. Pour y arriver, des emplois ont du être créés et qui sont par définition, inutiles. Des troupes entières de gens, en Europe et en Amérique du Nord particulièrement, passent leur vie professionnelle à effectuer des tâches qu’ils savent sans réelle utilité. Les nuisances morales et spirituelles qui accompagnent cette situation est profonde. C’est une cicatrice qui balafre notre âme collective. Et pourtant personne n’en parle. ( ... )
Quels sont donc ces nouveaux emplois précisément? Un rapport récent comparant l’emploi aux Etats Unis entre 1910 et 2000 nous en donne une bonne image (et je notes au passage, il en est de même pour le Royaume Uni). Au cours du siècle dernier, le nombre de travailleurs, employés dans l’industrie ou l’agriculture a dramatiquement diminué. Au même moment, les emplois en tant que “professionnels, clercs, managers, vendeurs et employés de l’industrie de service” ont triplés, passant “de un quart à trois quart des employés totaux”. En d’autres mots, les métiers productifs, comme prédit, a pu être largement automatisé (même si vous comptez les employés de l’industrie en Inde et Chine, ce type de travailleurs ne représente pas un pourcentage aussi large qu’avant) ( ... )
C’est comme si quelqu’un inventait des emplois sans intérêt, juste pour nous tenir tous occupés. Et c’est ici que réside tout le mystère. Dans un système capitaliste, c’est précisément ce qui n’est pas censé arriver. Dans les inefficaces anciens états socialistes, comme l’URSS, où l’emploi était considéré comme un droit et un devoir sacré, le système fabriquait autant d’emploi qu’il était nécessaire (une des raisons pour lesquelles il fallait trois personnes pour vous servir dans les supermarchés un morceau de viande). Mais, bien sûr, c’est le genre de problème que le marché compétitif est censé régler. Selon les théories économiques, en tout cas, la dernière chose qu’une entreprise qui recherche le profit va faire est de balancer de l’argent à des employés qu’ils ne devraient pas payer. Pourtant, cela arrive en quelque sorte.
Alors que les entreprises s’engagent dans des campagnes de licenciement, celles ci touchent principalement la classe des gens qui font, bougent, réparent ou maintiennent les choses, alors que à travers une alchimie bizarre que personne ne peut expliquer, le nombre de salariés “pousse-papier” semble gonfler, et de plus en plus d’employés se retrouvent, au contraire des travailleurs de l’ex URSS, travaillant 40 ou 50 heures par semaine, mais travaillant de façon réellement efficace 15 heures, comme Keynes l’avait prédit, passant le reste de leur temps à organiser ou aller à des séminaires de motivation, mettre à jour leur profile facebook ou télécharger des séries télévisées.
La réponse n’est clairement pas économique: elle est morale et politique. La classe dirigeante a découvert qu’une population heureuse et productive avec du temps libre est un danger mortel (pensez à ce qui c’est passé lorsque cette prophétie à commencé à se réaliser dans les années 60). Et, d’un autre côté, le sentiment que le travail est une valeur morale en elle même, et que quiconque qui ne se soumet pas à une forme intense de travail pendant leur temps de veille ne mérite rien, est particulièrement pratique pour eux. ( ... )
Je ne voudrais pas dire à quelqu’un, qui est convaincu qu’il effectue une réelle contribution à l’humanité et au monde, que en fait, non. Mais qu’en est-il des gens qui sont convaincus que leur travail n’a pas de sens? Il y a peu j’ai repris contact avec un ami d’enfance que je n’avais pas vu depuis l’âge de 12 ans. J’ai été étonné d’apprendre, que dans l’intervalle, il était d’abord devenu un poète, puis le chanteur d’un groupe de rock indépendant. J’avais entendu certaines de ses chansons à la radio, sans savoir que c’était quelqu’un que je connaissais. Il était clairement brillant, innovant, et son travail avait sans aucun doute illuminé et amélioré la vie de gens au travers du monde. Pourtant, après quelques albums sans succès, il perdit son contrat, et plombé de dettes et devant s’occuper d’un jeune enfant, finit comme il le dit lui même “à prendre le choix par défaut de beaucoup de gens sans direction: la fac de droit”. Il est aujourd’hui un avocat d’affaires travaillant pour une firme proéminente newyorkaise. Il était le premier à admettre que son travail n’avait aucun sens, ne contribuait en rien au monde, et de sa propre estimation, ne devrait pas réellement exister. ( ... )
Il existe une classe entière de professionnels qui, si vous deviez les rencontrer dans une soirée et admettent que vous faites quelque chose d’intéressant (un anthropologiste, par exemple), feront tout pour éviter de discuter leur travail. Après quelques verres, ils risquent même de se lancer dans des tirades sur combien leur travail est stupide et sans intérêt.
Cela est profondément psychologiquement violent. Comment peut on commencer à discuter de dignité au travail, quand on estime que son travail ne devrait même pas exister? Comment cette situation ne peut-elle pas créer un sentiment profond de rage et de ressentiment? Pourtant et c’est tout le génie de cette société, dont les dirigeants ont trouvé un moyen, comme dans le cas des cuiseurs de poisson, de s’assurer que la rage est directement dirigée précisément vers ceux qui font un travail qui a du sens. Par exemple, dans notre société, il semble y avoir une règle, qui dicte que plus le travail bénéficie aux autres, moins il sera payé pour ce travail. Encore une fois, une mesure objective est difficile à trouver, mais un moyen simple de se faire une idée est de se demander: qu’arriverait-il si cette classe entière de travailleurs disparaissait? Dites ce que vous voulez à propose des infirmières, éboueurs ou mécaniciens, mais si ils venaient à disparaître dans un nuage de fumée, les conséquences seraient immédiates et catastrophiques. Un monde sans profs ou dockers serait bien vite en difficulté, et même un monde sans auteur de science fiction ou musicien de ska serait clairement un monde moins intéressant. Ce n’est pas complètement clair comment le monde souffrirait de la disparition des directeurs généraux d’entreprises, lobbyistes, chercheurs en relation presse, télémarketeurs, huissiers de justice ou consultant légaux (Beaucoup soupçonnent même que la vie s’améliorerait grandement). Pourtant à part une poignées d’exceptions (les médecins), la règle semble valide.
De façon encore plus pervers, il semble exister un consensus sur le fait que c’est la façon dont les choses devraient se passer. C’est un des points forts secrets du populisme de droite. Vous pouvez le voir quand les tabloids s’en prennent aux cheminots, qui paralysent le métro londonien durant des négociations: le fait que ces travailleurs peuvent paralyser le métro, montre que leur travail est nécessaire, mais cela semble être précisément ce qui embête les gens. C’est encore plus clair aux Etats Unis, où les Républicains ont réussi à mobiliser les gens contre les professeurs d’école ou les travailleurs de l’industrie automobile (et non contre les administrateur des écoles ou les responsables de l’industrie automobile qui étaient la source du problème) pour leurs payes et avantages mirifiques. C’est un peu comme si ils disaient “mais vous pouvez apprendre aux enfants! ou fabriquer des voitures! c’est vous qui avez les vrais emplois! et en plus de ça vous avez le toupet de demander une retraite et la sécu?”
Si quelqu’un avait conçu un plan pour maintenir la puissance du capital financier aux manettes, il est difficile de voir comment ils auraient mieux fait. Les emplois réels, productifs sont sans arrêt écrasés et exploités. Le reste est divisé en deux groupes, entre la strate des sans emplois, universellement vilipendé et une strate plus large de gens qui sont payés à ne rien faire, dans une position qui leur permet de s’identifier aux perspectives et sensibilités de la classe dirigeante (managers, administrateurs, etc.) et particulièrement ses avatars financiers, mais en même temps produit un ressentiment envers quiconque à un travail avec un valeur sociale claire et indéniable. Clairement, le système n’a pas été consciemment conçu, mais a émergé d’un siècle de tentatives et d’échecs. Mais c’est la seule explication pourquoi, malgré nos capacités technologiques, nous ne travaillons pas 3 à 4 heures par jour.




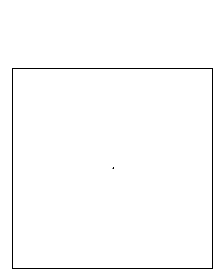
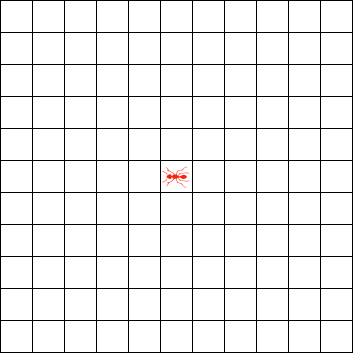

.gif)

