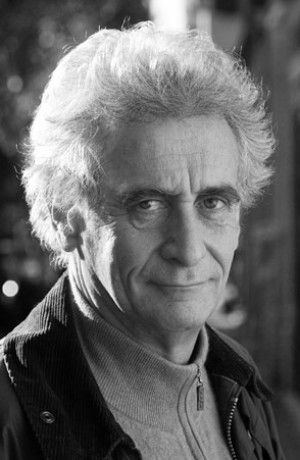« La colossale expansion matérielle de ces dernières années a pour destin, selon toute probabilité, d’être un phénomène temporaire et transitoire. Nous sommes riches parce que nous vivons sur notre capital. Le charbon, le pétrole, les phosphates que nous utilisons de façon si intensive ne seront jamais remplacés. Lorsque les réserves seront épuisées, les hommes devront faire sans… Cela sera ressenti comme une catastrophe sans pareille. »
« Le progrès : comment les accomplissements de la civilisation vont ruiner le monde entier » Vanity Fair ( 1928 )
« Le prolétariat ». C’est Karl Marx qui a enrichi le charabia mort et infâme des politiciens, des journalistes et des gens sérieux (charabia qui, dans certains cercles, est superbement qualifié de « langage de l’idéologie moderne ») avec ce mot. « Le prolétariat ». Pour Marx, ces cinq syllabes désignaient quelque chose d’extrêmement déplaisant, quelque chose de déshonorant pour l’humanité dans son ensemble, et pour la bourgeoisie en particulier. En les prononçant, il faisait référence à la vie dans les villes industrielles britanniques de la première moitié du 19ème siècle.
Il pensait aux enfants travaillant 216 heures par mois pour un shilling. Aux femmes que l’on utilisait — en lieu et place du cheval, plus coûteux — dans les mines, afin de pousser les chariots de charbon. Aux hommes accomplissant à l’infini des tâches à la chaîne dans des environnements ignobles, dégradants et malsains, afin de gagner suffisamment pour que leurs familles ne meurent pas de faim. Il pensait à toutes les choses iniques qui avaient été faites au nom du Progrès et de la Prospérité Nationale. À toutes les atrocités que tous les bons chrétiens, hommes et femmes, avaient complaisamment acceptées, et auxquelles ils avaient participé personnellement, parce qu’elles étaient jugées inévitables, autant qu’un lever ou qu’un coucher de soleil, parce qu’elles se déroulaient supposément en accordance avec les lois positivement divines et immuables de l’Économie Politique.
Les esclaves salariés du début et du milieu du 19ème siècle étaient bien plus maltraités que les esclaves captifs de l’antiquité et des temps modernes. Fort logiquement ; un esclave captif était un bien précieux, et personne ne détruit sans raison un bien précieux. Ce n’est qu’à partir du moment où la conquête rendit les esclaves extrêmement nombreux et bon marché que les classes de propriétaires s’autorisèrent à user de leurs ressources humaines de manière extravagante. Ainsi les Espagnols décimèrent toute la population aborigène des Antilles en quelques générations. L’espérance de vie d’un esclave indien dans une mine était d’environ un an. Après l’avoir travaillé à mort, le propriétaire de la mine achetait simplement un nouvel esclave, pour trois fois rien. Les esclaves étaient un produit naturel du sol que les Espagnols se sentaient libres de gaspiller et d’épuiser, tout comme les Américains se sentent aujourd’hui libres de gaspiller et d’épuiser le pétrole.
l’approvisionnement en esclaves était limité, les propriétaires faisaient plus attention à leurs possessions. L’esclave était alors traité avec au moins autant de soin qu’une mule ou un âne. Les industriels du 19ème siècle étaient comme des conquérants se retrouvant soudainement avec des quantités énormes d’esclaves à utiliser. La machinerie avait augmenté la production, des terres plus ou moins vierges fournissaient une nourriture abondante et bon marché, tandis que des nitrates importés augmentaient le rendement. Tout était en place pour que la population augmente, et lorsque tout est en place pour que la population augmente, elle le fait, rapidement, au début, puis, lorsqu’une certaine densité est atteinte, sa croissance ralenti.
Les industriels du siècle passé vivaient à l’époque d’une augmentation fulgurante de la population. L’approvisionnement en esclaves était infini. Ils pouvaient donc se permettre d’être extravagants et, tout en anesthésiant leur conscience à l’aide de la pensée rassurante qui voulait que tout cela fût en accord avec les lois d’airain qui étaient si populaires dans les cercles scientifiques de l’époque, et à l’aide de la croyance chrétienne qui leur promettait que leurs esclaves salariés recevraient compensation dans un Monde Meilleur, ils l’étaient ! Impitoyablement ! Les esclaves salariés étaient diligemment travaillés à mort ; mais il y en avait toujours de nouveaux pour prendre leur place, qui imploraient loyalement les capitalistes de les travailler à mort eux aussi. (...)
Plus le degré de développement industriel et de civilisation matérielle (qui diffère, d’ailleurs, de la civilisation tout court) s’élève, plus la transformation du prolétariat progresse. Dans les pays les plus industrialisés, le prolétariat n’est plus une abjection ; il est prospère, son mode de vie se rapproche de celui de la bourgeoisie. Il n’est plus victime et, dans certains endroits, il devient même oppresseur.
Les origines de ce changement sont diverses et nombreuses. Dans les méandres de l’âme humaine se trouve ce que l’on articule comme une soif de justice. Il s’agit d’un sentiment obscur de la nécessité d’un équilibre dans les affaires de la vie ; nous le concevons comme une passion pour l’équité, une faim de justesse. Un déséquilibre évident, dans le monde, indigne cette pulsion pour l’équité, en nous, graduellement et cumulativement, jusqu’à nous pousser à réagir, souvent de manière extravagante, contre les forces qui génèrent ce déséquilibre. Tout comme les dirigeants aristocratiques de la France du 18ème siècle étaient poussés, par cette soif d’équité, à prêcher l’humanitarisme et l’égalité, à renoncer à leurs privilèges héréditaires et à céder sans combattre aux exigences des révolutionnaires, ainsi les dirigeants industriels bourgeois du 19ème siècle passèrent des lois pour limiter leur propre cupidité, redistribuèrent une part croissante de leur pouvoir au prolétariat qu’ils avaient si scandaleusement opprimé et même, dans certains cas, prirent un plaisir masochiste à se sacrifier eux-mêmes en s’offrant à leurs victimes, en servant leurs serviteurs et en étant humiliés par les opprimés. (...)
L’objectif du capitalisme moderne est d’apprendre au prolétariat à être gaspilleur, d’organiser et de faciliter son extravagance, tout en rendant possible cette extravagance à l’aide de bons salaires permettant une bonne productivité. Le prolétariat nouvellement enrichi est encouragé à dépenser ce qu’il gagne et même à hypothéquer ses futurs salaires dans l’achat d’objets que les publicitaires présentent persuasivement comme des nécessités, ou tout au moins comme des luxes indispensables. L’argent circule et la prospérité de l’État industriel moderne est assurée — du moins, jusqu’à ce que les ressources planétaires ainsi dilapidées commencent à se raréfier. Cependant, cette éventualité demeure toujours distante — du point de vue de la vie individuelle, pas de celui de l’histoire et encore moins de celui de la géologie. (...)
Les maçons gagnent plus que beaucoup de médecins, de dessinateurs, de chimistes, de professeurs et ainsi de suite. Cela est en partie dû au fait que les travailleurs manuels sont plus nombreux et mieux organisés que les travailleurs intellectuels, et qu’ils sont ainsi plus en mesure de négocier avec les capitalistes ; et en partie dû à l’engorgement des professions à cause d’un système éducatif qui produit plus de travailleurs intellectuels qu’il n’y a de postes à pourvoir — ou qu’il n’y a de cerveaux aptes au travail !) (...)
Le véritable problème du présent système social et industriel n’est pas qu’il rende certaines personnes bien plus riches que d’autres mais qu’il rende fondamentalement la vie insupportable pour tout le monde. Maintenant que non seulement le travail mais aussi les loisirs ont été complètement mécanisés ; qu’à chaque innovation de l’organisation sociale, l’individu se voit davantage déshumanisé et réduit à une simple fonction sociale ; que des divertissements prêts à l’emploi qui évacuent l’esprit créatif diffusent un ennui de plus en plus intense à travers une sphère de plus en plus étendue — l’existence est devenue insignifiante et intolérable. Cependant, les masses de l’humanité matériellement civilisée ne le réalisent pas encore.
Actuellement, seuls les plus intelligents s’en rendent comptent. Une telle réalisation pousse ceux dont l’intelligence n’est accompagnée d’aucun talent, d’aucune pulsion créatrice, vers une haine immense, un besoin de détruire. Ce type de personne a été admirablement et effroyablement décrit par André Malraux dans son roman Les Conquérants, que je recommande à tous les sociologues.
Nous ne sommes plus très loin du temps où toute la population, et non plus seulement quelques individus particulièrement intelligents, réalisera consciemment l’invivabilité de la société actuelle. Qu’adviendra-t-il ensuite ? Consultez M. Malraux. La révolution qui s’ensuivra ne sera pas communiste — il n’y aura aucun besoin d’une telle révolution, comme je l’ai expliqué, en outre personne ne croira en une amélioration de l’humanité ou en quoi que ce soit d’autre d’ailleurs.
Il s’agira d’une révolution nihiliste. La destruction pour la destruction. La haine, la haine universelle, et donc une démolition sans but, complète et minutieuse de tout ce qui existe. Et l’augmentation des salaires, en accélérant l’expansion de la mécanisation universelle (la machinerie est coûteuse), ne fera qu’accélérer l’avènement de cette grande orgie de nihilisme universel. Plus nous nous enrichissons, plus nous nous civilisons matériellement, plus cela adviendra vite. Tout ce que l’on peut espérer, c’est que cela n’arrive pas de notre vivant.
" Révolutions " Vanity Fair ( 1929 )